Chapitre 11 - Dernier flamenco
.
.
.
C'est Michèle qui interrompit ma lecture. Profitant des premiers rayons de soleil, elle s'était absentée de la maison pour une balade revigorante. J'imaginais déjà cette promenade axée sur la lutte contre elle-même. Sans boussole et sans carte topographique dessaouler en pleine nature, enfouir sa gueule de bois sous un monticule d'humus et transpirer à chaudes gouttes après vingt mètres de marche... Tout cela s'annonçait pénible. Mais j'avais tort. Sa virée matinale ne fut pas un chemin de croix, loin de là. Ce ne fut pas non plus une communion avec dame nature mais quand Michèle poussa la porte de notre chambre je décelai derrière son sourire radieux que ce fût un moment de bonheur léger. La marche, l'air frais et les deux efferalgans 1000 l'avaient ragaillardi. Plus rien ne laissait deviner sa récente alcoolisation. Mais lorsqu'elle m'aperçut allongé sur notre lit son sourire s'effaça pour laisser place à un visage pétri d'interrogation. Ce regard je m'y attendais, c'est pourquoi à notre retour, la maison vide, j'avais demandé à Carol-Anne de gagner sa chambre. Retrouver ses jouets le temps que je panse ma blessure. Et puis j'avais besoin de parler à sa maman. Le genre de conversation dont on éloigne un enfant. Dans notre pharmacie peu fournie je trouvai de quoi nettoyer la plaie à ma cuisse gauche. La balle du stupid cop m'avait caressé et par chance était allée se loger ailleurs. Mais la caresse était appuyée et le sang coulait en abondance. Et à mesure que mon sang pénétrait le coeur de la fibre synthétique, mon pantalon prenait du poids. Vase communiquant. Je me vide il se remplit. Je me sentais faible. J'ingérai alors divers cachetons dont les indications thérapeutiques et la posologie m'étaient inconnues. Mais les couleurs me plaisaient. Un rouge, un orange, un jaune. J'étais pas loin de faire un arc-en-ciel. Puis je me glissai nu sous le drap et bientôt le pansement céda. Je n'avais ni la compétence d'un médecin ni le savoir-faire d'une infirmière. Mon sang en profita et colora le drap. Voilà pourquoi le sourire de Michèle la quitta lorsqu'elle me trouva dans la chambre. Et sans prétention aucune je crois pouvoir dire qu'elle se souciait davantage de ma santé que du drap souillé comme si une blessure de balle avait ce don de révéler la femme sensible cachée derrière la rigoureuse maîtresse de maison. Presque terrifiée elle entreprit de trouver des réponses à ses interrogations. « Que se passe-t-il ici ? Qu'est-ce que c'est que tout ce sang ? Et où est Carol-Anne???». Je lui répondis « Carol-Anne est là aussi. Dans sa chambre. Elle va bien. Il s’est produit un accident. ». Elle s’assit sur le bord du lit, prête à écouter. Le morbide attire toujours l’attention. Succinctement je lui résumai ma sale matinée, évoquant le corps inanimé de son frère, puis la déraison qui m’avait fait visiter son logement avec la hache et le pistolet. J’évoquai mon altercation avec la police et ma fuite paniquée mais omis volontairement ma rencontre avec la petite dame. Dans ce genre de situation la concision se doit de l’emporter sur les détails encombrants. Ma non-folichonne histoire terminée, Michèle semblait avoir bien du mal à réaliser. Demain il nous faudrait organiser des obsèques et nous trouver des vêtements adéquats. Elle s’effondra sur notre lit et déchaînée frappa à plusieurs reprises le matelas. Une scène larmoyante d'un classicisme affolant. Après quelques minutes de défoulement Michèle sécha ses larmes et telle une enfant, sans mot dire, vint se réfugier dans mes bras. J'étais un époux minable, impassible et froid, incapable d'offrir ce minimum de tendresse et de réconfort. J’attendais le temps, j'attendais longtemps. Nous restâmes là collés l’un à l’autre, dans une espèce de fausse communion. Je cessai tout mouvement, bloquai ma respiration, dans l'espoir que le sablier temporel se fige. Espoir vain. De toute manière mon heure n'était pas venue. Je voulais connaître le fin mot de cette histoire. Les flics devaient être en route vers la maison. Il fallait faire vite. Le mouvement est perpétuel, rien n’est figé. Alors, je brisai le recueillement de mon épouse et lui posai la question qui fâche « Tu n'en parle jamais et jamais je ne t'ai questionné. Je crois cependant que tu me caches quelque chose, quelque chose de terrible. Jusqu'alors je n'ai pas voulu remuer le passé, ton passé. Mais à présent il le faut. L'accident de tes parents... Leur décès... Je n'y crois plus. Tu dois me le dire. Michèle, ta mère n’est pas morte avec ton père dis le moi. Que lui est-il arrivé ? » Déconcertée par ma question elle reprit difficilement ses esprits. Je lui montrai le livre d’écriture de Carol sur ma table de chevet. « C'était son journal. Tu sais ma chérie, j'ai commencé à le lire et il y dévoile certaines choses... » Michèle devint alors très pâle comme éprise d'une honte à l'idée de me savoir au courant de son passé. Elle s’agenouilla sur le lit pour me faire face et se servit un verre d’eau.
« La mort de papa m’a profondément choqué. Lui, tu peux me croire, est bien mort dans un accident de la circulation. Pendant des années la haine avait comme pissé à travers toutes les pores de leurs peaux. Un père et une mère sur un même bateau. C'était couru d'avance l'un des deux devait couler. Sans vraie raison, si ce n’est la lassitude, ils se détestaient. De la haine sans demi-mesure et affichée sans pudeur sous nos yeux de gosses. Nous n'étions pas vraiment là. La maison était une zone de guerre et le combat ne tolérait pas le dimanche comme jour de repos. Nous étions des spectateurs forcés assistant à la destruction de nos parents. Quand il est mort, ce fut une victoire de maman, ses mots avaient été les plus durs. Je savais que c’était un accident, mais je ne pouvais m’empêcher de penser qu'elle avait agit en usant de quelques odieux maléfices. Juste avant qu'il ne prenne sa voiture, son « bijou » comme il l'appelait, elle lui avait hurlé « Crève salopard ». Oh bien sûr cela pouvait être une coïncidence mais moi et Carol nous étions convaincu du contraire. Elle avait en elle une force, une force malsaine, un pouvoir noir qu'elle utilisait pour faire le mal. Et derrière son apparence de circonstance à la mise en bière de papa, je la voyais... Elle fulminait, n’osant faire exploser sa joie matinée de rage. Moi je décidai de me terrer. Le dangereux pouvoir des mots m’était apparu je ne voulais pas le provoquer. Encore moins ressembler à ma mère. Obstinée, je refusais alors de participer à toute forme de communication familiale. Tout cela me répugnait. J’observais et tendais l’oreille. Carol tournait mal. En vain il cherchait à unifier cette famille. Il se voulait le ciment. Mission impossible tant l'aversion que je ressentais pour ma mère était ancrée. Elle se trouva rapidement désœuvrée, alors elle nous épia. Il lui fallait bien déverser sa haine quelque part. Et nous étions tout désigné. Pour moitié nous étions notre père alors en totalité nous devenions coupables. En quelques mois j’eus l’impression de devenir femme. À l’écart je me forgeais. Je fabriquais mon armure seule car seule je serai pour affronter notre bourreau. J'étais l'aînée et pour la première fois de ma vie je prenais conscience de mon rôle et de son importance. Cela m'explosait à la vue. Je me devais de le protéger. Lui, mon petit frère en froid avec notre mère. Alors j’attendais le bon moment. Je savais qu’il me faudrait agir vite car nous allions mourir. La courbe de la souffrance était exponentielle. Régulièrement elle nous refaisait le visage. D'abord à la lame de cutter puis directement à la meuleuse. C'était un cadeau de Noël. Mon blindage s'épaississait de jour en jour. J'étais dénuée de tout sentiment envers celle qui m'avait retenue prisonnière neuf mois dans son utérus. Et quand elle passa à l’action avec sa meuleuse, elle se heurta à ma carapace. Elle l'esquinta, elle l'abîma mais jamais ne la brisa. Mon âme était en sécurité. Contrairement à Carol qui hurlait, je souffrais en silence. Cette paix, qui de moi émanait, la tuait. Alors, désespérant de me voir geindre, elle accentua son coup de manivelle. Mais c'était trop tard. Qu'importe la torture je refusais de chialer ou de la supplier. Un soir elle nous tira du lit vers minuit. Une heure à laquelle elle aimait exercer sa dermatologie expérimentale. Elle nous obligea à descendre au sous-sol où se tenait le quartier général de la souffrance. Le QG de la terreur. Ce soir là Carol ne se laissait pas attacher et n'avait de cesse de se débattre. Carol était recroquevillé à terre et elle, elle s’époumonait sur lui en hurlant dans son l’espagnol dégueulasse qu’elle affectionnait « Mire a su hermana, hijo de bastardo! » Carol n’en pouvait plus, il était saisi de convulsion intense proche de la crise d'épilepsie. Mais elle, elle était insensible à son cinéma. Elle accomplissait son devoir de destruction sans fléchir. Mais putain quel était son but? Était-elle une héritière des techniques de réduction de têtes des Indiens Jivaros? Bordel ce qu'elle nous en a fait baver... Alors ce soir là ne pouvant ramener Carol à la raison elle le laissa à terre comme une merde et conclut sur mon visage son œuvre de purification. Il aurait pu mourir. Fort heureusement ce ne fut pas le cas. Quand elle nous recoucha ce soir là, je vis mon frère céder à la folie. C’en était trop. Elle au rez-de-chaussée, dans sa cuisine, se remplissait le bide bouteille après bouteille comme pour célébrer son travail accompli avec sérieux et honnêteté. Sa langue en décrépitude lançait infamie sur ignominie. Et quand elle se fut bien minée la gueule, et eut regagnée son lit de veuve, je me levai. Je n'avais pas parlé depuis des mois. C'est ce qu'ils croyaient. Tu parles... En fait je n'arrêtais pas de parler, de me parler... Mon activité cérébrale n'avait jamais été aussi intense. Et en moi cela chantait quelque chose comme "Femme au levi's serré ou robot aux vis serrées, peu m'importe car moi j'men vais t'éviscérer..." Je passais chaque jour à tourner ma vengeance dans mon petit crâne. Et ce soir là elle allait s'exprimer. Ils me trouvaient transparente presque invisible j'allais me rappeler à leur bon souvenir. La force noire venait de changer de main... La haine malsaine au bout de mes veines. Pieds nus, la chemise de nuit tachée par le sang qui de mon visage avait coulé, je descendis les escaliers. Maintes et maintes fois j’avais préparé ce moment. Je connaissais chaque marches et soigneusement évitai celle qui la nuit grinçaient. Sur les dix-sept, quatre se réveillaient d’humeur bougonne si je les effleurais du pied. Quoi de plus logique personne n'aime se faire marcher dessus en pleine nuit. Dans la cuisine s'élevait une rance odeur de vinasse. Je savais où elle rangeait les meilleurs couteaux. J'en attrapai un. Pas un petit. Non un large couteau à viande. Du genre avec lequel on découpe les bêtes les plus coriaces. Les questions sur le bien fondé de mon geste étaient somnolentes. J'avançais vers sa chambre. Un sentiment de sérénité m'accompagnait. Le cycle de la vie s’écrit ainsi. Mon père m’avait giclé dans ma mère. À l'intérieur de son antre je n'avais pas su la détruire. Une deuxième chance s'offrait à moi, je n'allais pas la laisser passer. Elle pionçait lourdement dans son lit trop grand. La gueule grande ouverte. Sur ce point mon père avait raison. Dans son relâchement, elle ressemblait à une truie. Et effectivement, l'envie de l’abattre était décuplée même si ce n'était pas pour en faire de la saucisse. Elle n’ouvrit les yeux qu’une fois la lame entièrement enfoncée dans sa poitrine. Elle nous avait tant emmerdé avec son dialecte hispanisant qu'il était grand tant de lui offrir une dernière danse. The Last Splash. Qu'elle puisse se donner en rythme à une lame. Vas-y offre toi avais-je envie de lui dire, remue la plaie autour du couteau. Elle voulait du dépaysement je lui offrais une honorable mort de samouraï Japonais. Hara-Kiri le suicide assisté des gastronomes en culotte courte. Nul demande de pardon dans son regard, juste la terreur de l’instant. Un seul coup suffit pour la saigner. Je lui ouvris l'abdomen de haut en bas. Les mains jointes sur le manche elle tenta sans conviction d’arracher la lame. Sa cavité buccale emplie de sang, elle me cracha un ultime « Puta » et s’éteignit. Il était quatre heures, la nuit touchait bientôt à sa fin. Je regagnai mon lit, Carol n’avait rien entendu. Car il n'y avait rien à entendre. Cette femme n'avait pas la pureté d'âme d'une Madame Butterfly. Ici pas de regret dans la mort. Ici, pas de poignard sur lequel serait gravé "Celui qui ne peut vivre dans l'honneur meurt avec honneur". Non rien de tout cela. Une mort froide, clinique presque chirurgicale. Tout simplement. Je venais d'opérer maman de la vie, cette curieuse maladie qui la rongeait depuis sa naissance. Notre souffrance allait enfin prendre fin. Alors, le lendemain j’avais retrouvé la parole et j'appelai la police. Après une enquête de routine, l'inspecteur en charge de l'affaire conclut à un suicide. La presse s'en mêla et l’histoire des enfants torturés fit grand bruit dans la région. Notre histoire tira tellement de larmes que personne n'osa me soupçonner du meurtre. Carol et moi fûmes séparés. Ce fut d'abord la clinique spécialisée puis la famille d'accueil jusqu'à ma majorité. Huit années de longue séparation. Je retrouvai Carol à sa sortie. J'étais une jeune adulte. Tandis que j'avais envie de m'épanouir dans cette nouvelle vie qui se profilait, Carol ne pensait que vengeance. Il ruminait depuis si longtemps sa colère... Selon lui, la presse, les gendarmes, le juge, les médecins tous étaient responsables de nos maux. Ils n'avaient pas le droit de nous séparer. Pour tout oublier, il me fallait, il nous fallait couper les ponts de manière radicale. Fatigués d'être des célébrités locales nous quittâmes alors notre région natale pour cette ville où je t’ai rencontré. Loin de tout ce que nous avions connu, loin des gens, loin des lieux, un vent d'air frais courait sur nos visages limés. Avec toi, j’ai aimé et mes plaies se sont cicatrisées. Carol n’a jamais su que c’est moi qui ai suicidé maman. Il ne le saura jamais. Il croyait en la version officielle de sa mort, en son hara-kiri sans honneur. Une mort pleine de lâcheté disait-il. J’ai toujours voulu rester près de lui. Toujours être sa grande sœur. Aujourd'hui je sais que j’ai failli, sa mort est mon échec. Je me rends compte que l'on ne peut fuir son passé et même si c'est un lieu commun je te le dis, le passé finit toujours par nous rattraper. J’espère que maman brûle encore et qu’au ciel il ne l’a retrouvera pas. »
Elle termina son verre et se fendit d'une petite larme. Je l'embrassai puis elle quitta notre chambre pour monter consoler Carol-Anne. Je soufflais, mon enquête était close. Le brouillard s'était levé. Et tout était limpide. Carol était un être fragile, mentalement perturbé par une famille tout aussi perturbée. Il n'avait jamais accepté d'être éloigné de sa sœur et reprochait cette séparation à toute la société. Une vraie thérapie lui eut été profitable mais imprégné de principes tous aussi stupides que son « les affaires de familles se règlent en famille » il ne s'était jamais extrait de son marasme. Incapable de trouver sa place il n'avait pas d'autre solution que d'en finir avec sa vie. À présent, je savais que l'avenir serait difficile puisque Michèle ne manquerait pas de se reprocher de ne pas avoir été assez présente auprès de son frère. En attendant j'étais satisfait d'avoir bouclé la boucle. J'étais confiant. Les flics allaient bientôt se pointer, je leur expliquerai tout et ils comprendraient. Au pire je serais poursuivi pour avoir frappé à la hache un jeune policier municipal mais pas pour le meurtre de Carol. Soulagé, je jetai un œil au cahier de Carol et décidai d'en achever sa lecture. Par respect de l'œuvre et de son auteur. Mal m'en prit.
... to be continued
la suite sera en ligne mercredi 2 mai


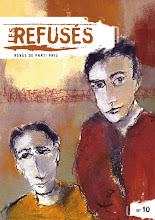
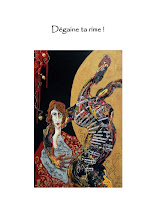




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire