1ère Partie - Undercore - Chapitre 1 - Je connais ce mort
« Non, baiser n'est pas un bon calcul. Ca coûte même très cher. Mais ça fait passer le temps. Et quand le désir de baiser est parti, on se rend compte qu'on a plus rien à faire dans ce monde. Et qu'il n'y a jamais rien eu d'autre dans cette putain de vie. Rien qu'un programme de reproduction inscrit au fond de nos tripes, et qu'on se croit obligé de respecter. Naître malgré soi, bouffer, agiter sa queue, faire naître, et mourir. La vie est un grand vide. (…) Tiens, si je pouvais recommencer une existence, je devrais faire du porno. Là, au moins, c'est clair. Les gens qui font ça, ils ont tout compris au sens de notre espèce. Soit t'es né avec une bite, et tu n'es utile que si tu te comportes comme une bonne bite bien dure qui bourre des trous. Soit t'es né avec un trou, et tu ne seras utile que si tu te fais bien bourrer. Mais dans les deux cas, t'es tout seul. Oui, moi je suis une bite. C'est ca. Je suis une misérable bite. Et pour me faire respecter, il faudra que je reste toujours bien dur. »
extrait de Seul contre Tous
de Gaspar Noé
« j’irai au paradis car l’enfer est ici »
titre du film de Xavier Durringer et Philippe Missonnier
Chapitre 1 - Je connais ce mort
Cette dernière phrase mettait un point final à son journal que je ramassais sur le siège passager de son véhicule abandonné. A la place du mort. Détachés de ce monde. Les pieds. Carol avait fait de la culture de la défaite un mode de vie au sein duquel il s’enfonça quotidiennement. Et le mode de vie vira à la recherche artistique puis cailla en enfouissement spirituel. Tout cela j’allais bientôt le découvrir. Car moi, le Carol en question, je ne l’avais jamais vraiment calculé.
Quand Michèle me l’avait présenté je l’avais pourtant accepté. Une acceptation par alliance. Rien à voir avec celle à l’avance. L’image de la scène remonta à la surface tel un condamné à qui l’on n’aurait pas assez appuyé sur la tête et effaça mes considérations de l’instant. Suicide. Sa mort par ablation des pieds, je la percevais comme une douloureuse symbolique de son refus contestataire d’aller de l’avant. Pour ce (son) cadeau au monde, Carol avait dû écumer les nombreux champs de réflexion de la défaite. Qu'elle soit professionnelle, sentimentale, physique, artistique ou bien sexuelle, la recherche de la perte était un devoir pour cet enfant perdu. Quand bien même le décès était soigneusement mis en scène il me fut douloureux au regard. Je n’avais jamais observé un corps dans le détail de sa mort. Et naïvement je ne m’y étais jamais préparé. A mon grand dam. C’est pour moi comme une révélation, un signe de là haut. La densité urbaine est si importante de nos jours qu’il est quasi-impossible de vivre sans croiser un mort. L’on croise tellement de vivants. La seule solution semble être la vie de reclus. Et si le risque de tomber sur un mort est proportionnel à la densité de population alors j’espère que dans les mégagigalopoles genre Tokyo l’on enseigne aux enfants la manière d’appréhender un corps qui se vide de tous ses pores. Pour ma part, personne ne m’avait inculqué pareil savoir. Au mieux j’avais cru qu’il me suffirait d’agir comme un héros quelconque de série télé merdique, prendre le pouls du défunt, pousser un soupir consterné, appeler une ambulance avec un discours de circonstance et puis reprendre le cours d’une journée bien mal entamée. Manque d’entraînement ou improvisation ratée de l’instant, toujours est-il que, pas de chance, je m’emmêlais dur les pinceaux.
Et pourtant c’était avec sérénité que la matinée avait commencé. Lever à sept heures malgré un coucher tardif, c’était probablement là ma première erreur. C’est pourtant simple. Si tu picoles soit fainéant et fous-toi en arrêt le lendemain. C’est cette logique que j’aurais dû adopter ce matin. Au lieu de cela j’avais laissé défiler au radio-réveil les titres de Paoli puis avais bondi du plumard faisant fi de ma légère alcoolisation de la veille. Même si je ne me considérais pas vraiment porté sur le goulot, un spécialiste aurait probablement détecté, en auscultant mes habitudes de consommation, une sérieuse accoutumance histoire de justifier ses honoraires. Depuis mon mariage, je n’avais pour ainsi dire jamais vidé la moindre bouteille alone. Mais dès qu’un invité prenait place dans l’accueillant canapé alors, oui, rapidement je trouvais le chemin qui menait à la cave. Ce matin c’était Michèle qui occupait le canapé. Hier soir, elle n’avait pas trouvé la force de rejoindre notre chambre. Après le départ de Carol, il était près de 5h00 du mat, elle avait liquidé ses ultimes forces dans le récurage tefal puis avait sombré dans le confort moelleux de notre mobilier design. Recroquevillée sous un ample t-shirt, vestige de mon époque étudiante, elle dormait profondément quand je descendis l’escalier. Contemplatif je la regardais, la trouvant belle dans sa légèreté naturelle. Il semblait régner dans sa longue chevelure, d’ordinaire soigneusement peignée et attachée vers l’arrière, un désordre monstre semblable à un vaste terrain vague. Le petit Nicolas aurait pu inviter ses copains pour une partie de football. Moi je trouvais ça drôle. De la voir ainsi avachie on aurait dit une intello Woodyalien saoul d’un « ex-ce-llent » bordeaux from France. Michèle était un spectacle à elle seule pouvant passer d’un éclat de rire à un éclat de sanglots en une fraction de seconde. Et Carol avait le don de provoquer ce changement brutal. Lorsque le carillon de la porte d’entrée avait retentit hier soir je rentrais tout juste du travail. Il était 19h00, l’heure de l’apéro. Michèle récupérait Carol-Anne à la sortie de l’école tous les jours. Elle ne supportait pas l’idée de laisser notre enfant à la garderie encore moins chez une nounou. Alors elle avait aménagé ses horaires de travail. A ce moment de sa carrière c’était comme un sacrifice professionnel mais elle s’en foutait, elle voulait profiter de sa fille. Au risque de se fermer certaines portes qu’elle avait eu pourtant grand mal à entrouvrir. Michèle était comme ça. Ce qui lui importait le plus c’était sa famille et elle avait toujours besoin de se le prouver. Une solution différente pour la garde de Carol-Anne aurait pu être envisagée mais Michèle en aurait été trop lourdement affectée. Son amour existait au travers de ce qu’elle laissait de côté pour privilégier notre petite Carol-Anne. Pas d’amour vrai sans sacrifice visible semblait être le message qu’elle voulait faire passer. Alors quand ce soir là le carillon résonna elle se précipita vers la porte d’entrée en appelant Carol-Anne qui sur le canapé les yeux mi-clos suçait son pouce : « Carol Anne réveille-toi ma chérie voilà tonton ! » Carol-Anne qui avait effectué le plus gros du chemin censé la mener au pays des songes écarquilla les yeux comme effrayée. Et lorsque le mot « tonton » eut cheminé jusqu’à son cerveau une expression de bonheur se dessina soudainement sur le visage de mon enfant. « Onc’arol, Onc’arol, Onc’arol » se mit-elle à balbutier en gesticulant. C’était comme cela à chaque fois qu’il nous rendait visite. Et à raison d’une à deux fois par semaine, Carol était vite devenu le tonton préféré. Lorsqu’il pénétra dans le vestibule une étrange impression m’envahit. Si ma femme était une morte-vivante voilà à qui elle ressemblerait. A Carol. Quiconque les aurait croisés sans les connaître au préalable n’aurait pu nier l’évidence physique. Leurs ressemblances étaient frappantes. Et Michèle avait beau avoir traversé quatre printemps et autant d’hivers de plus que Carol, ils étaient comme des jumeaux. Carol était doté, du moins lorsque je l’avais rencontré, d’une beauté androgyne. Un équilibriste des deux sexes. Filiforme, des traits fins, un visage doux et délicat. Et puis pour des raisons qui m’étaient inconnues son corps avait commencé à se décharner monstrueusement. Sa peau semblait couler sur son visage formant ainsi d’épaisses et hideuses rides. Et son poids comme s’il lorgnait vers le zéro absolu était devenu indécent. Alors ce soir-là, et bien que leur lien de parenté ne puisse être éluder, Carol m’apparut comme l’incarnation morte-vivante de Michèle, ma douce et aimante femme. Mais peut-être étais-je le seul à déceler la lente putréfaction qui voulait envelopper son corps. Car son aspect physique n’altérait en rien le plaisir que ressentait Michèle à le recevoir. D’autant plus qu’il était, si l’on excluait moi et Carol Anne, sa seule famille.
De ce que je savais leurs parents avaient disparu très tôt dans leur enfance. Elle m'avait parlé d'un accident de la route fatal. Michèle et Carol s’étaient alors élevés mutuellement. Plus qu’un sujet que Michèle rechignait à évoquer c’était un véritable tabou. Jamais je ne devais parler de son enfance. Elle n’en gardait d’ailleurs aucun souvenir matériel. Pas de photos, pas de vieux vêtements, pas de paperasse scolaire. Rien. Un passé enterré. Alors, vu le peu de famille qui restait à Michèle, elle en prenait grand soin. Ce soir-là Carol provoqua de nombreux fous rires chez sa sœur. Elle aimait particulièrement le regarder jouer avec Carol-Anne au jeu de cartes qu’il lui avait offert quelques mois auparavant. C’était rapidement devenu le jeu fétiche de Carol Anne. Dans ce jeu chaque carte représentait une lettre de l’alphabet. Mais ce qui rendait le jeu si particulier c’était l’holographie. Ainsi selon son inclinaison, la carte laissait apparaître la lettre en majuscule ou en minuscule. Et Carol-Anne adorait ça. Oui elle adorait le jeu de Onc’arol. Ils s’amusaient avec pendant des heures mélangeant les lettres pour inventer des mots et phrases issus d’un imaginaire qui à moi et ma femme demeurait inaccessible. Ce soir là encore, Carol Anne se mit à courir à travers toute la maison hurlant à qui voulait bien l’entendre des phrases sans queue ni tête du genre « midjid e tit desvomehit ryom geyv tewuos jedjis ». Autant dire pas évident pour le profane. Quand Carol-Anne s’était éprise de ce jeu, Michèle avait craint que cela puisse nuire à son apprentissage du français. Alors elle en avait parlé avec la maîtresse du primaire et aussitôt celle-ci l’avait réconfortée. Carol-Anne était une enfant particulièrement douée. Je ne sais pas à quel point mais tandis que ses camarades de classe peinaient encore à distinguer le « ge » du « gue », elle, elle dévorait nos vieux romans tirés de la bibliothèque rose. La maîtresse pensait que ces exercices linguistiques que Carol-Anne pratiquait, au travers du jeu de cartes avec son tonton, étaient de nature à développer son imaginaire et être favorable à son épanouissement personnel comme disent les gens éduqués. Alors on les laissa continuer sans s’en soucier. Et on se marra à les regarder. La bienséance obligea alors Carol à gagner le salon où l’apéritif ne demandait qu’à se faire boire. Ce fut le début de la petite larme de Michèle. Car Carol n’avait pas la drôlesse d’esprit qu’il affirmait avec Carol-Anne lorsqu’il conversait avec les adultes, c’est à dire ceux de son âge. Il divaguait une fois. Il divaguait deux fois. L’alcool aidant, Carol évoquait son détachement nouveau par rapport à toute chose à grands coups de « j’emmerde tout ». Il théorisait quant à son indépendance vis à vis du bien matériel. « A la différence de la chose vouée à être consommée, j’existe sans être obligé de me vendre…et c’est là ma rayonnance ». Michèle supportait ce discours mais je sentais qu’elle en bavait. Ils étaient l’antithèse dans l’acte de consommation mais les liens du sang étant ce qu’ils sont, ils s’aimaient plus que tout.
Lorsque Carol avait décidé d’arrêter de se nourrir pour vivre pleinement son échec gastronomique, nous décidâmes de l’inviter régulièrement pour lui offrir un minimum calorique ainsi qu’une vigilance médicale. Notre stratagème était soigneusement rodé. Jamais nous ne devions employer l’invitation directe « salut Carol, tu passes dîner ce soir ? » mais plutôt un détour du style « Carol-Anne te réclame, viens donc après le taf. » Malléable après un ou deux apéros, il acceptait plus facilement de passer à table bien qu’il nuançait toujours par un « vite fait alors, j’ai un truc à boucler faut pas qu’je traîne ». Nous savions qu’il ne faisait rien et nous l’acceptions. Et ce matin tandis que je descendais l’escalier en contemplant mon épouse je laissais ses discours vaseux s’estomper avec mon taux d’alcool. Le silence avait reprit sa place anéantissant le désordre sonore de la veille. Je préparai discrètement les petits déjeuners, disposant les sets de table sur notre salon de jardin. Il faisait beau et sous les rayons de soleil illuminant notre récente terrasse nous effacerions nos abus de la soirée. Au contact de mes lèvres amoureuses, Michèle se réveilla difficilement. Autant pour moi un grand bol de café noir avait le pouvoir de me requinquer, autant pour Michèle les migraines post-alcoolisation étaient telles qu’elles agissaient dans sa tête comme une équipe de marteaux piqueurs dépourvus de silencieux défonçant à pleine puissance une roche réputée indestructible. Encore somnolente elle gagna la salle de bains, fouilla l’armoire à pharmacie et s’envoya ce qu’elle y trouva. Deux efferalgans 1000. Cela aurait pu être sa réponse à la question « quelle est la première chose que vous faîtes le matin en vous réveillant ? » Dans son état l’organisation de la journée prenait une volée. Changement de plan. Ce matin, ce serait moi qui conduirais Carol-Anne à son école. Maman possède trop de circonstances aggravantes, me faudrait-il expliquer sur le chemin nous conduisant. Et la route peut bien être connue, archi-connue les surprises aiment à se fourrer là où on les attend le moins. Et voilà, comment sur une longue ligne droite, votre vie prend un sale tournant. Carol-Anne avait probablement encore à l’esprit les fous rires de la veille avec son Onc’arol. Ils avaient mis sans dessus dessous la maison, avaient déliré avec leurs mots et phrases de fabrication artisanale et puis Carol-Anne s’étaient endormie en écoutant l’une de ses histoires.
Nous n’avions pas parcouru deux kilomètres depuis la maison quand Carol-Anne un peu trop observatrice remarqua judicieusement « Papa, c’est la voiture à tonton là-bas ? ». C’était un modèle standard de gamme moyenne et de couleur commune. Cela aurait pu être le véhicule de n’importe quel peckno du village. Mais il y avait un détail qui ne trompait pas Carol Anne. L’immatriculation. Les quatre premiers chiffres correspondaient au jour et au mois de naissance de Carol-Anne. 2904. Détail qui nous avait tous amusés. Aussi quand elle insista de nouveau « Papa, on vient de croiser la voiture de Onc’arol sur le bord de la route » je sus que le doute pouvait bien faire ses bagages et se casser. Un bref coup d’œil dans le rétro et j’entamai la marche arrière. L’école de Carol-Anne se situait à mi-chemin entre notre maison de banlieue et l’appartement de Carol en plein cœur de la ville. Pour cette raison, sa présence ici à cette heure matinale était tout sauf normale. Il n’y avait pas de raison de s’arrêter ici à moins d’en être forcé. Une route bordée de culture. Sa voiture. Recouverte de bruine. Le capot froid. Le doute qui m’habitait s’estompa. Carol n’était pas rentré chez lui après nous avoir quittés. Un kilomètre et puis s’en va. Ainsi font font font.
Les portières n’étaient pas verrouillées, les clés sur le contact. Sur le siège passager un livre. Ou plutôt un cahier. Une patrouille bleue l’aurait peut-être arrêté. Car après ce que nous avions vidé sûr qu’il méritait la cellule de dégrisement. Mais réfutant notre invitation à dormir sur place il avait tenu à prendre le volant en détournant le slogan de la sécurité routière ce qui donnait quelque chose du genre « Celui qui conduit c’est celui qui picole ». Et quand il y mettait tout le sérieux qu’imposait la prévention routière et toute sa conviction d’imitateur il était difficile de ne pas se tordre de rire. J’espérais un moment cette possibilité d’arrestation mais n’y croyais pas vraiment. Sur cette départementale entourée de champ de maïs, jamais je n’y avais croisé de justicier en képi. Carol-Anne, de nouveau, fut la plus observatrice. « On dirait que quelqu’un a marché dans le champ ». Les traces de pas formaient un sillon encore visible, bien que les épis, vaillants et courageux, se relevaient à la recherche de leur position initiale. Il y aurait peut-être été pisser puis se serait endormi sur place. Me remémorant une nouvelle de Stephen King, dont le titre m’échappe, « les enfants du maïs » ou quelque chose d’approchant, j’hésitais à avancer en compagnie de ma petite encore si fragile. Mais le besoin de savoir à ses inconvénients. « Donne-moi la main mon bébé, on va faire un tour dans le champ. Ne t’inquiètes pas, on sera à l’heure pour l’école ».
Délicatement la brise matinale s’engouffrait dans les cheveux de Carol-Anne, les faisant virevolter. Le soleil réchauffait nos visages et nourrissait la culture environnante. S’il n’y avait eu ce corps inerte, nous aurions pu croire à un spot publicitaire vantant les valeurs familiales et l’amour des choses simples, d’un produit alimentaire de type céréales. Mais il y avait ce corps et je le connaissais. Or Corn flakes ne découpe pas ses acteurs dans ses films car un bol de lait aux céréales sensé couvrir près de 25% de l’apport énergétique total journalier n’a pas besoin en plus de transformer les hommes en cadavres. Un nuage passa, le vent se leva. Avec véhémence, il s’en alla plaquer sur l’ingénu visage de Carol-Anne ses courts cheveux longs. C’était comme s’il voulait lui dissimuler l’atroce spectacle. L’éloigner de l’horreur pour le bien-être de l’innocence infantile. Mais à quoi bon préserver la candeur d’un enfant quand la cruauté du monde se refuse à raser les murs. Nous ne nous donnions plus la main et dans une jolie concordance père–fille de la gestuelle nos bras tombèrent le long de nos corps.
Le corps de Carol reposait là sous notre regard à jamais marqué. Mort. Onc’arol. Attendant patiemment la venue des premiers vautours avides de charogne. Une première mare de sang entourait ses chevilles. Ses deux pieds étaient séparés du reste de son corps. L’opération relevait plus de la boucherie que de la chirurgie comme en témoignait la présence dans la terre souillée de la hache incriminée. Un médecin apporterait rapidement le diagnostic selon lequel la hache avait violemment déchiqueté le tendon d’Achille. Puis, dans un probable élan de démence, Carol aurait lâché ses coups sans retenue aucune. L’astragale, qui des vingt-six os formant le pied est celui qui reçoit les os de la jambe, verticalement le tibia et latéralement le péroné aurait cédé face à cette déferlante brutale. Une fois dilacérés, ce furent les os du milieu qui subirent la loi des assauts incessants. Littéralement défoncés. Et re-belote avec le deuxième pied. Aussi, seule la présence des orteils miraculeusement intacts me permit de déduire que ces deux morceaux fait de chair et d’os maculés de sang étaient bien les pieds de feu Onc’arol. Je ramassai la hache, la contemplant comme subjugué. Je la tenais à distance de mon corps craignant qu’elle ne me saute au cou. Tout cela ressemblait à l’arrestation d’un psychopathe sur les lieux de son crime. Une hache de plus à errer dans nos établissements pénitentiaires qui, succès oblige, affichent complets depuis fort longtemps. Et si le sort de la hache était joué il n’en était pas de même pour celui du sang. Je le voyais, ce liquide couard, prendre la poudre d’escampette. S’infiltrant sous terre, aidé en cela par la terre elle-même qui en l’absence de papilles gustatives avale tout ce qui lui passe à travers la gueule. J’espérais en l’existence de suceurs de sang parmi les différentes races de vers peuplant le premier mètre de la croûte terrestre. Ainsi la fuite rouge serait anéantie. Un véritable festin s’insinuant dans les profondeurs. Il y aurait du goût chez nos amis les bugs-vampires. Je parcourus du regard le corps de mon invité de la veille jusqu’à rejoindre la seconde mare de sang. Elle se présentait comme un oreiller sur lequel la tête fraîchement explosée reposait. Confortable oreiller, mais sans plus. Ici, l’arme était un simple pistolet. Je ne m’y connaissais pas suffisamment en arme à feu pour déterminer le modèle et le calibre avec précision. Toutefois sa redoutable efficacité était incontestable. Allez savoir en quoi elle m’aurait transformé si j’avais eu l’insouciance de douter de sa puissance de feu. En candidat pour le cimetière probablement. Sa balle avait traversé l’œil droit et était allée percuter la boite crânienne sans même prendre le temps de visiter le cerveau obscur se présentant à elle. Je me sentais fébrile devant ce cadavre et n’étais pas le seul. Les sons gutturaux de Carol-Anne me sortirent soudain de ma torpeur. A genoux, les paumes appuyées contre le sol, elle se vidait les tripes sous mon regard éteint. Ses jets de salive se mélangeaient à ses larmes. Elle releva son visage éploré et me supplia de partir. Foutre le camp. Disparaître de cet enfer de maïs pour n’y jamais revenir. Brusquement je la saisis, la portai à mes bras et détalai sans me retourner. Armé d’une hache. Armé d’un flingue.
En repassant devant la voiture de Carol je vis à l’intérieur son cahier d’écriture. Intrigué par cet ouvrage j’ouvris la portière et le volai. Une fois Carol-Anne installée je fis vrombir mon moteur et détalai comme un dératé. J’étais dans un état nerveux bien trop élevé. Le rythme de mon palpitant n’avait de cesse d’accélérer pour atteindre des cadences capables d’essouffler le plus téméraire des raveurs. Il me fallait retrouver mon calme. Je roulai ainsi de longues minutes à la recherche d’un endroit où me poser. Un parking de supermarché, une aire de repos peu m’importait. Je connaissais une station service en bordure d’autoroute. Un café à la boutique serait le bienvenu. Beaucoup trop de choses se bousculaient dans mon esprit et je n’y comprenais rien. Et puis, il y avait ce cahier. Anodin dans sa forme je comptais pourtant sur lui pour me révéler ce qui avait conduit Carol à l’irréparable. Parmi le flou qui m’encerclait je n’avais qu’une seule certitude. Aujourd’hui, nous n’irions pas. Carol-Anne à l’école et moi chez les forces de l’ordre.
.... To be continued
le chapitre 2 sera en ligne mercredi 21 février.


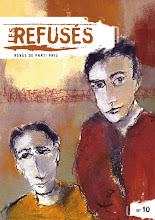
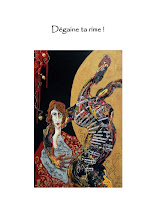




2 commentaires:
salut mon tyler,
j'ai encore rien lu, mais j'en suis déjà tout excité. Alors même si c'est pas génial -ce qui est impossible, vu que tout ce que tu écris est terrible- l'idée de nous le faire enfin partager est admirable.
Dd
"Soit t'es né avec une bite, et tu n'es utile que si tu te comportes comme une bonne bite bien dure qui bourre des trous. Soit t'es né avec un trou, et tu ne seras utile que si tu te fais bien bourrer." ho ho dites moi pas qu'c'est pas vrai..Vous c pas en enfer qu'vous allez finir c en Roumanie!
Enregistrer un commentaire